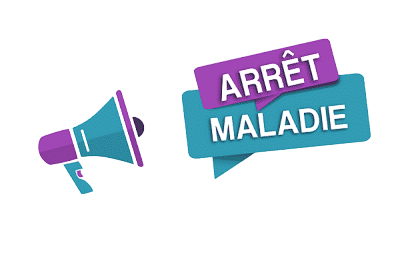
BASTIEN SCORDIA
28 février 2025, 11:04, mis à jour le 28 février 2025, 11:07
La baisse de l’indemnisation des arrêts maladie
entre en vigueur dans la fonction publique : ce
qu’il faut savoir
La baisse de 100 à 90% de l’indemnisation des agents publics durant leurs arrêts maladie
entre en vigueur ce 1 mars. Les incidences seront multiples sur leur rémunération et
n’impactera pas seulement leur traitement indiciaire. Explications.
La réforme des arrêts maladie entre en vigueur dans la fonction publique. C’est en effet à
compter de ce samedi 1er mars que s’appliquera la baisse de 100 à 90 % de
l’indemnisation des agents publics durant leurs arrêts maladie de courte durée, c’est-à-
dire ceux de trois mois maximum. Une mesure toujours vivement critiquée par les
syndicats et les employeurs territoriaux et hospitaliers.
Cette réforme vient d’ailleurs d’être finalisée ce vendredi 28 février avec la publication au
Journal officiel des décrets transposant cette mesure aux contractuels. Pour les
fonctionnaires, elle a été actée dans le cadre de la loi de finances pour 2025 promulguée
le 15 février dernier.
Cette baisse de la rémunération s’appliquera ainsi aux congés de maladie accordés à
compter de ce 1er mars. Le gouvernement Barnier, pour rappel, prévoyait d’aller encore
plus loin en appliquant cette mesure aux arrêts maladie déjà en cours à la date de
promulgation de la loi de finances. Une application rétroactive que le gouvernement
Bayrou n’a donc pas reprise à son compte.
Des incidences multiples
Mais, alors, quelles seront les implications concrètes de cette réforme sur la
rémunération des agents publics en arrêt maladie ? Cette baisse de 100 à 90 % de leur
indemnisation ne concernera pas seulement le traitement indiciaire. Elle s’appliquera
aussi dans la même mesure à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ainsi qu’au
complément de traitement indiciaire (CTI) éventuellement perçus.
Les primes seront également impactées puisque, selon les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les régimes indemnitaires de la fonction publique suivent le
sort du traitement indiciaire en cas d’arrêt maladie. Ces primes, et notamment
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), seront donc aussi réduites de
100 à 90 % en cas d’arrêt maladie de courte durée.
L’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG sera également réduite dans les
mêmes proportions. La réforme n’a en revanche aucune incidence sur le supplément
familial de traitement (SFT) ou l’indemnité de résidence (IR) qui seront conservés dans
leur totalité en cas d’arrêt maladie de courte durée.
PAR BASTIEN SCORDIA
3 mars 2025, 11:35, mis à jour le 3 mars 2025, 15:24
Avec la réforme des arrêts maladies, l’État
contraint de renforcer sa vigilance sur le temps
partiel thérapeutique
Déjà pointées du doigt par les inspections, les situations d’aubaine et pratiques
d’optimisation du recours au temps partiel thérapeutique sont de nouveau redoutées par
les employeurs publics avec la baisse de l’indemnisation des arrêts maladie.
L’administration a été saisie sur cette problématique et n’exclut pas des corrections.
L’assouplissement des modalités d’octroi du temps partiel thérapeutique (TPT) serait-il
détourné dans la fonction publique ? La question avait été soulevée par l’inspection
générale des finances (IGF) et l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans leur
« revue des dépenses » de fin 2024 sur l’absentéisme dans la fonction publique. La
problématique se fait aujourd’hui plus grande chez les employeurs publics dans le
contexte notamment de la baisse de l’indemnisation des agents publics pendant leurs
arrêts maladie de courte durée.
Une ordonnance de novembre 2020 et des décrets de 2021 avaient, pour rappel, élargi la
portée de dispositif de maintien et de retour à l’emploi en ouvrant notamment la
possibilité de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique en l’absence d’arrêt
maladie préalable. Depuis lors, l’autorisation de travailler à temps partiel pour raison
thérapeutique est en effet accordée et renouvelée sur présentation d’un simple
certificat médical. Sauf avis défavorable du conseil médical, il est accordé pour une
période d’un à trois mois dans la limite d’un an. Les agents qui en bénéficient perçoivent
l’intégralité de leur rémunération durant ce temps partiel.
Des « pratiques d’optimisation »
Certes, expliquaient les inspections dans leur rapport, « l’ensemble des employeurs
s’accordent pour souligner la plus-value du TPT comme alternative à un congé pour raison
de santé et comme dispositif de lutte contre la désinsertion professionnelle ».
Mais « certaines modalités de recours au dispositif peuvent entraîner des situations
d’aubaine », ajoutaient l’IGF et l’IGAS en relevant une augmentation du nombre de
placements en temps partiels thérapeutiques.
Lors de ses échanges avec la mission d’inspection, la direction générale de
l’administration et de la fonction publique (DGAFP) disait ainsi avoir « identifié des
pratiques d’optimisation du recours au TPT ». Des pratiques grâce auxquelles ces agents
pouvaient pérenniser une activité à temps partiel sans perdre leur traitement. « C’est ce
que permet une alternance entre une période de congé de longue maladie rémunérée à
plein traitement et un TPTY à 50 % sur un an pendant lequel les droits à congé de longue
maladie se reconstituent », indiquaient à titre d’exemple l’IGF et l’IGAS.
« Assez marginal » selon la DGAFP
« Le dispositif est contourné et pose de véritables problèmes d’organisation, confirme
aujourd’hui un DRH ministériel. Plutôt que de se mettre en congé maladie et perdre de la
rémunération, de plus en plus d’agents sollicitent un temps partiel thérapeutique ». Et,
abonde ce DRH, « la situation ne devrait pas s’améliorer avec la baisse du taux de
remplacement qui est entrée en vigueur ce 1 mars pour les arrêts maladie jusqu’à trois
mois ».
Questionnée par Acteurs publics sur le sujet, la DGAFP dit avoir été sollicitée par des
ministères sur ce sujet et reconnaît que l’assouplissement des modalités d’octroi du TPT
a pu générer des dérives. Mais « c’est assez marginal statistiquement », affirme la direction.
« Et s’il faut corriger le dispositif, on le fera », ajoute-t-on. Avant cela, la DGAFP pourrait être
amenée à rappeler prochainement les règles sur l’octroi de ce temps partiel
thérapeutique « pour éviter les confusions et aider les employeurs à contenir un pic de
demandes ». L’IGF et l’IGAS appelaient quant à elles à une évaluation du dispositif au vu du
coût qu’il peut représenter.
Augmentation du nombre de bénéficiaires
Les employeurs publics interrogés par les inspections ont bien signalé « un
développement du recours au TPT sous l’effet des réformes et des assouplissements
ces dernières années ». Ceux-ci ne disposent pas pour autant « systématiquement de
statistiques consolidées » sur le nombre de bénéficiaires. L’IGF et l’IGAS citaient
néanmoins le cas des Armées où le nombre de bénéficiaires a augmenté de 84 %
entre 2021 et 2023. Cette hausse est de 50 % entre 2021 et 2022 aux ministères
économiques et financiers.
